|
CP Métiers de l’ingénieur : démultiplier nos ambitions | 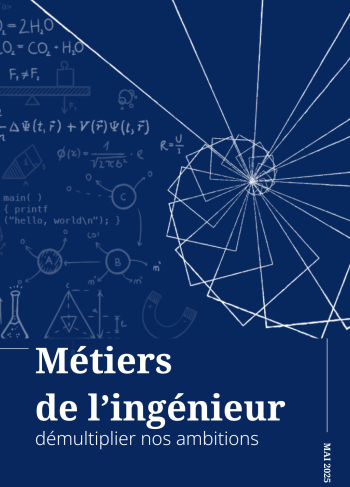 |
|
|
Dans un contexte marqué par les enjeux de compétitivité, les ambitions de réindustrialisation, l’accélération du numérique – notamment de l’intelligence artificielle – et l’impératif écologique, une réponse forte s’impose : la France doit impérativement renforcer son vivier de compétences scientifiques et techniques pour maintenir son rang économique et technologique. Si les annonces du “Plan Filles et Maths” et de “Choose France for Science” constituent des premiers jalons, elles doivent s’accompagner d’une stratégie plus globale pour répondre aux tensions croissantes sur les profils scientifiques. Pour combler ce déficit et accompagner ses ambitions, l'économie française aura besoin de près de 100 000 recrutements nets d’ingénieurs et de techniciens par an d’ici 2035 - un objectif qui nécessitera, sans compter les 40 000 reconversions professionnelles, la formation d’environ 60 000 diplômés supplémentaires chaque année.
C’est le constat sans appel du nouveau rapport de l’Institut Montaigne intitulé “Métiers de l’ingénieur : démultiplier nos ambitions”, porté par Éric Labaye (ancien président de l’École polytechnique et de l’Institut Polytechnique de Paris) et Aiman Ezzat (directeur général de Capgemini).
Sur la base d’un diagnostic étayé par des données inédites, ce travail collégial propose : - Une évaluation des besoins futurs de l'économie selon 4 hypothèses de réindustrialisation
- Une approche globale du système de formations des filières scientifiques (du bac+2 au titre d’ingénieur diplômé)
- 9 recommandations opérationnelles pour augmenter considérablement le nombre de diplômés aux métiers de l’ingénieur
- 3 des pistes concrètes de financement sans alourdir le déficit public
 «Nous devons former le tiers d’une classe d’âge aux métiers scientifiques, et les former pour l’emploi. Cela demande du pragmatisme : adapter les moyens aux débouchés, avec des formations plus souples et réactives face aux évolutions technologiques. Deux impératifs nous mobilisent : l’un quantitatif, pour répondre à la pénurie de compétences, l’autre culturel, pour transformer notre ambition éducative.» Marie-Pierre de Bailliencourt, directrice générale de l’Institut Montaigne  «La réussite d’une réindustrialisation de la France d’ici 2035 demande d'accroître de plus de 40% les diplômés des métiers de l’ingénieur soit environ 60000/an. Renforcer la culture scientifique dans l’enseignement primaire et secondaire est critique afin d’inspirer plus de jeunes à faire des études scientifiques. Les écoles d’ingénieurs et les universités doivent élargir leur vivier de recrutement, en particulier en le féminisant et en l’internationalisant, toujours adapter leurs formations aux besoins de l’économie, avoir la capacité d’expérimenter et revaloriser les métiers de techniciens en ingénierie. Et tout ceci est possible sans augmentation de fonds publics !» Éric Labaye, ancien président de l’École polytechnique et de l’Institut polytechnique de Paris  «Pour répondre aux défis majeurs de la transition vers une économie plus digitale et plus durable, la France a urgemment besoin de plus d’ingénieurs et de techniciens. Cela passe notamment par la revalorisation des métiers de techniciens, avec des parcours de formation bac +2 et 3 concrets, accessibles et en adéquation avec les réalités du terrain, ainsi que par de nouvelles passerelles vers le titre d’ingénieur en cours de carrière. Les entreprises ont aussi un rôle clé à jouer dans cette transformation : elles doivent reconnaître ces profils à leur juste valeur.» Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini
|
|
|
Un déséquilibre critique entre besoins économiques et capacité de formation La France fait face à une pénurie structurelle de compétences scientifiques et techniques. Dans un scénario modéré de réindustrialisation (portant la part de l’industrie à 12 % du PIB), il faudra former chaque année 28 000 ingénieurs et 29 000 techniciens supplémentaires d’ici 2035 — soit une hausse de 36 % pour les ingénieurs et 54 % pour les techniciens. Pourtant, 70 % des recruteurs peinent déjà à embaucher des ingénieurs, et plus de 80 % jugent les recrutements de techniciens difficiles. Le manque d’attractivité des carrières scientifiques trouve ses racines bien avant l’université : il commence dès l’école. Il est donc essentiel d’agir dès le plus jeune âge pour susciter des vocations, mais aussi de mieux accompagner l’orientation tout au long du parcours scolaire, afin d’élargir le vivier de futurs talents scientifiques. Face à ces tensions, l’ensemble des viviers existants des formations scientifiques – de la primaire aux écoles d’ingénieurs – doit être repensé. Il est temps de considérer les filières scientifiques comme un écosystème cohérent, du bac+2 au bac+5, et de valoriser massivement les parcours techniques, aussi essentiels que les parcours d’ingénieurs. |
|
4 leviers d’actions pour augmenter le nombre de diplômés : attirer, diversifier, réallouer et revaloriser Axe 1 : remettre à l’honneur la culture scientifique dès l’école - Recommandation 1 :réhabiliter la culture scientifique dès l’enseignement primaire et poursuivre cet effort dans le secondaire, pour donner aux collégiens et aux lycéens l’envie et les moyens de nourrir une ambition scientifique.
- Recommandation 2 : responsabiliser davantage les lycées dans l’orientation des élèves, si nécessaire en fixant des objectifs chiffrés cohérents avec les besoins de l’économie.
Axe 2 : diversifier les recrutements et donner une capacité d’expérimentation aux écoles d’ingénieurs - Recommandation 3 : élargir le vivier dans lequel peuvent puiser les écoles d’ingénieurs aux étudiants en réorientation, des secteurs de la santé et des sciences de la vie et, de façon subsidiaire, en CPGE économiques.
- Recommandation 4 : se fixer l’objectif d’accueillir au moins 40 % de jeunes femmes et doubler le nombre d’étudiants étrangers dans les écoles d’ingénieurs.
- Recommandation 5 :octroyer un droit à l’expérimentation aux écoles d’ingénieurs déjà accréditées par la CTI pour créer de nouvelles formations, afin d’améliorer la réactivité de l’offre de formation d’ingénieurs aux besoins de l’économie, dans un contexte de mutations technologiques rapides.
Axe 3 : rendre les formations universitaires plus en phase avec les besoins de l’économie - Recommandation 6 :porter à 25 % la part des formations universitaires en sciences et sciences de l’ingénieur par une réallocation des ressources depuis d’autres filières pour lesquelles l’économie exprime moins de besoins. Cela permettrait de créer de l’ordre de 66 000 places en licence et master en sciences et sciences de l’ingénieur.
- Recommandation 7 : aligner le niveau de professionnalisation des formations universitaires sur celui des écoles d’ingénieurs, notamment grâce à une augmentation des périodes de stages et une plus grande association des entreprises à la gouvernance des cursus.
Axe 4 : Revaloriser les formations et les métiers au niveau bac+2 et bac+3 - Recommandation 8 :transformer les Bachelors universitaires de technologie (BUT) scientifiques en « Bachelors en sciences de l’ingénierie » (BESI), afin de rapprocher la sémantique des diplômes d’ingénieurs. L’appellation « technicien en ingénierie » pourrait participer de cette revalorisation.
- Recommandation 9 : ajuster le référentiel de la CTI afin de faciliter l’accès au titre d’ingénieur diplômé en cours de carrière, pour encourager les diplômés non ingénieurs à entrer sur le marché du travail au niveau bac +2 ou bac +3.
|
|
3 leviers identifiés pour financer l’ambition sans creuser le déficit : - une augmentation du nombre d’élèves par professeur dans les différentes filières pour répondre à 32 % des besoins pour les formations d’ingénieurs et master et 43 % des besoins pour les formations de niveau bac+2/bac+3 ;
- une augmentation de la part des formations aux sciences et sciences de l’ingénieur à l’université en réallouant les ressources en faveur des formations scientifiques de l’enseignement supérieur permettrait de répondre à 18 % des besoins en master et 75 % des besoins en bac+3
- une augmentation ciblée des frais de scolarité afin de compléter les besoins de financement générés par la création de places supplémentaires, soit 50 % des besoins au niveau ingénieur et master.
|
|
|
Retrouvez nos travaux associés : Ce rapport s’inscrit dans la continuité des travaux de l’Institut Montaigne sur l’éducation et le numérique notamment : Cette nouvelle note appelle à une action déterminée pour inverser la tendance préoccupante sur le niveau de mathématique observée dès le plus jeune âge. Elle identifie trois axes prioritaires et opérationnels pour permettre à la France de renouer avec l’excellence mathématique dans les années à venir. Dans un monde en pleine digitalisation, la pénurie de compétences numériques freine la compétitivité des entreprises françaises. Cette publication propose un chiffrage des besoins en formation et avance 12 recommandations articulées autour de trois leviers : l’attractivité, l’offre de formation, et la gouvernance du système. Cette enquête dessine le portrait d'une jeunesse attachée au travail, mais confrontée à un décalage prégnant entre les attentes qu'elle formule et la réalité des emplois qu’elle occupe, ouvrant ainsi la voie à des formes d’insatisfaction professionnelle. Menée auprès de 6 000 jeunes de 16 à 30 ans, elle décrypte cette relation complexe. |
|
|
|
À propos de l’Institut Montaigne Créé en 2000, l’Institut Montaigne est un espace de réflexion, de propositions concrètes, et d’expérimentations au service de l’intérêt général. Think tank de référence en France et en Europe, ses travaux sont le fruit d’une méthode d’analyse rigoureuse, critique et ouverte qui prennent en compte les grands déterminants sociétaux, technologiques, environnementaux et géopolitiques afin de proposer des études et des débats sur les politiques publiques. Association à but non lucratif, l’Institut Montaigne organise ses travaux autour de quatre piliers thématiques : la cohésion sociale, les dynamiques économiques, l’action de l’État et les coopérations internationales. Menés dans la collégialité et l’indépendance, l’Institut Montaigne réunit des entreprises, des chercheurs, des fonctionnaires, des associations, des syndicats, des personnes issues de la société civile et d’horizons divers. Nos travaux s’adressent aux acteurs publics et privés, politiques et économiques, ainsi qu’aux citoyens engagés. Depuis sa création, ses financements sont exclusivement privés, aucune contribution n'excédant 1,2 % d'un budget annuel de 7,2 millions d'euros. |
|
|
|